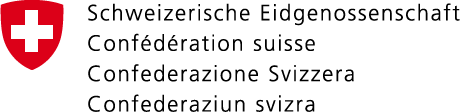Gérer les crises, les catastrophes et les situations fragiles
La protection des victimes de crises humanitaires et de catastrophes ainsi que leur soutien constituent l’une des priorités de la coopération internationale de la Suisse. L'action helvétique se concentre en particulier sur les contextes fragiles. En 2017, la DDC a travaillé en particulier sur les liens entre la faim et les conflits, la réduction des pertes de récoltes et le soulagement des populations ayant vécu des traumatismes sociaux.

Recrudescence des cas de famine
En 2017, la famine a menacé le Nigéria, le Soudan du Sud, la Somalie et le Yémen. Environ 20 millions de personnes ont été plongées dans l’insécurité alimentaire en raison des conflits armés et du phénomène climatique El Niño. La DDC était déjà présente dans ces quatre pays avant que la famine ne se déclare. En 2017, elle a déployé des moyens supplémentaires pour renforcer l’aide d’urgence et les activités de coopération au développement.
Au bout de 30 ans, la lutte internationale contre la faim semblait porter ses fruits. Ces dernières années, l’objectif de développement durable «Faim zéro» était plus que jamais à portée de main. Mais, depuis 2016, la tendance s’inverse à nouveau: la famine affecte 815 millions de personnes dans le monde et, toutes les dix secondes, un enfant meurt des conséquences de la malnutrition ou de la sous-alimentation.
Outre les aléas météorologiques tels que les sécheresses, les conflits constituent la cause principale de la recrudescence mondiale des cas de famine, enregistrée depuis 2016. Or, la faim et les conflits se renforcent mutuellement.
Développement des activités en cours
En 2017, les conflits armés ont fait planer la menace d’une crise alimentaire d’une ampleur sans précédent au Nigéria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. La Suisse a immédiatement répondu à l’appel lancé en février 2017 par le Secrétaire général de l’ONU et mis à disposition 15 millions CHF supplémentaires pour l’aide d’urgence, afin de faire face à la crise alimentaire. Ces fonds ont permis de développer moyens de subsistance des populations et d’améliorer leur accès à l'eau potable. Une partie de ce montant a aussi servi à soutenir des activités du CICR et d’organismes de l’ONU, comme le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui viennent en aide aux réfugiés qui souffrent de la faim. La Suisse soutient en outre, depuis 2015 déjà, des actions humanitaires dans la région du Tchad. Depuis 2013, elle met en œuvre un programme régional dans la Corne de l'Afrique.
La réaction de la communauté internationale a permis, dans un premier temps, d’éviter une famine de grande ampleur. Mais les progrès réalisés dans les pays touchés sont mis à mal par les actes de guerres répétés, les conditions météorologiques défavorables et la faiblesse des structures de gouvernance. Il est particulièrement difficile d’éviter les crises alimentaires dans ces conditions. Les mesures d’aide, dont celles que déploie la Suisse, doivent sans cesse être adaptées. Avec une contribution s’élevant à 6 millions CHF, la Suisse est le principal donateur du Compte d’intervention immédiate du PAM. Les ressources peuvent être mobilisées en faveur des populations touchées en l’espace de 24 heures après l’éclatement d’une crise. Ainsi, 4000 tonnes d’aliments spéciaux ont pu être expédiées en Somalie pour venir en aide à plus d’un million de mères et d’enfants en danger. En 2017, la Suisse a encouragé les transferts de fonds (argents liquide ou bons) afin de mieux répondre aux besoins des populations concernées. Au cours des deux dernières années, 17 experts du Corps suisse d'aide humanitaire ont apporté leur soutien au PAM.
L’aide humanitaire ne constitue qu'une partie de la solution
Les crises alimentaires graves nécessitent une aide d’urgence immédiate. Mais l’aide d’urgence ne pourra à elle seule venir à bout de la faim dans le monde et des facteurs qui en sont à l’origine. C'est pourquoi la Suisse déploie en parallèle ses instruments relevant de l’aide humanitaire, de la coopération au développement et de la politique de paix, afin de protéger encore mieux les personnes vulnérables. Au Soudan du Sud, elle encourage la mise en place de services de conseils agricoles; au Nigéria, elle collabore avec des organisations partenaires pour aider le pays à se préparer aux périodes de sécheresse; au Yémen, elle met à disposition une plateforme consacrée aux pourparlers de paix.
Seule la paix, autrement dit une solution politique, permettra de mener à bien la lutte contre la faim et, en dépit des revers essuyés, l’objectif de développement durable «Faim zéro» peut encore être atteint.
Afrique australe: renforcement de la résilience rurale

L’an dernier je n’ai récolté que 10 sacs de maïs, au lieu des 130 que je peux obtenir quand la récolte est bonne, regrette Boyd Mungalu, petit agriculteur en Zambie, qui compte un million de petits exploitants. En Afrique australe, région frappée par la sécheresse, 25 millions de personnes sont sous-alimentées et souffrent de malnutrition chronique.
Réduction du risque grâce à des techniques agricoles améliorées et plus respectueuses
Transfert du risque grâce à l’accès à une assurance récolte
Répartition des risques par la diversification et les microcrédits; et épargne pour faire face aux situations d’urgence.
La DDC soutient la région par deux approches complémentaires: la première vise directement les petites exploitations agricoles, et la deuxième s’adresse aux décideurs des pays et, au niveau régional, de la Communauté de développement d'Afrique australe (Southern Africa Development Community, SADC).
Novatrice, l’initiative R4 invite les petits exploitants du Malawi, de Zambie et du Zimbabwe à adopter une gestion du risque différenciée.
L’initiative R4 fait le lien entre les institutions de microfinance et d’assurance privées, les gouvernements, les compagnies d’assurance internationales (la Swiss Re, p. ex.) et les agences de développement. Depuis que Boyd Mungalu est impliqué dans l’initiative R4, la culture d'espèces variées et résistantes à la sécheresse, associée à des méthodes agricoles ménageant les sols, lui garantit des récoltes plus sûres.
Le programme d'évaluation et d'analyse de la vulnérabilité régionale apporte un soutien aux pays de la SADC afin que les mécanismes de prévention, de soulagement et de rétablissement opèrent plus efficacement en situation de catastrophe. Grâce au projet de la DDC, les comités nationaux parviennent à systématiser la détection des lacunes de leurs pays respectifs en matière de malnutrition, de pauvreté, d’incidence de l’infection par VIH et de dégâts environnementaux. Les analyses amènent les pays et les régions à se doter de plans d’urgences et de plans de développement pour garantir une aide plus rapide et ciblée aux personnes dans le besoin.
L’art, une langue commune

L’art et la culture peuvent jouer un rôle clé pour panser les blessures sociales, en particulier au sortir d’une guerre. La DDC soutient des projets culturels dans les régions qui doivent faire face aux conséquences d’un conflit.
-

«Have Mercy» («ayez pitié») par la communauté de l’Agahozo Shalom Youth Village, Rwanda © Tom Martin
-

«Border Crossings» («traverser les frontières»), un projet résultant de la collaboration entre l’Ouganda et la RDC © Daniel Ecwalu
-

Scène de nuit, Kigali © Ubumuntu Arts Festival
-

«Desolation in Chains» («désolation enchaînée») par la spotlite crew, Ouganda © Daniel Ecwalu
L’Ubumuntu Arts Festival, au Rwanda, constitue l’un de ces projets. Organisé au centre commémoratif du génocide à Kigali, ce festival propose des performances artistiques, des ateliers et des débats, et rassemble des artistes issus de toutes les régions du globe. Pour Hope Azeda, créatrice et commissaire du festival, l'art représente une langue commune, une clé qui permet d’engager un dialogue concret et de refléter la vie telle qu’elle est.
Hope, quel est l’objectif principal de l’Ubumuntu Arts Festival?
Le festival se veut une plateforme invitant le public à réfléchir à des questions relevant de la justice sociale et a pour ambition d'aider les communautés à s’autonomiser. Il se concentre sur des valeurs humaines et, à travers l’art, facilite les échanges sur des sujets difficiles. En outre, nous cherchons à ouvrir un espace où les artistes peuvent développer leurs talents, laisser parler leur créativité et se créer un réseau.
L'art peut-il être considéré comme une langue commune dans les situations post-conflit?
Les discussions sont parfois très difficiles parce qu’elles rappellent des souvenirs douloureux et que les blessures ne sont pas encore refermées. J’ai grandi en Ouganda en tant que réfugiée et, quand je suis rentrée au Rwanda, j’ai vu dans la société un miroir brisé. Je pense que, dans les situations post-conflit, l’art est une passerelle, un pont. Il permet de refléter la vie telle qu'elle est et, à partir de là, on peut commencer à recoller les morceaux.
Quels sont les besoins pour faire progresser la professionnalisation des artistes au Rwanda?
Le Rwanda a besoin avant tout d’écoles d’art. La formation artistique aide les artistes à développer leur esprit critique, leur apprend comment aborder des sujets difficiles avec professionnalisme et communiquer librement au sein de la société.
Crise des réfugiés en provenance du Myanmar

Fin 2017, le Bangladesh accueillait plus de 650’000 personnes qui ont fui les violences au Myanmar voisin. Ces dernières se sont réfugiées dans la région frontalière de Cox’s Bazar. Elles ont tout abandonné et se retrouvent complètement démunies. De nombreux enfants ont perdu leurs parents
En 2017, la DDC a débloqué 8 millions CHF pour répondre à la détresse des Rohingyas. L’engagement humanitaire a permis de redonner aux réfugiés un accès à l’eau potable, à la nourriture et aux infrastructures d’assainissement. Il a aussi servi à la mise en place de sites pour abriter ces personnes arrivées en masse. L’Aide humanitaire de la DDC a également fourni du matériel de diagnostic et des équipements pour augmenter les capacités d’accueil de deux hôpitaux de la région de Cox’s Bazar. Cinq experts du Corps suisse d’aide humanitaire ont apporté leur soutien aux agences onusiennes. Compte tenu de l’importance de la crise, de son caractère probable sur le long terme et de son impact sur les communautés d’accueil, la DDC complétera l’engagement humanitaire par des activités de développement sur le plus long terme, en particulier pour appuyer les communautés d’accueil.
De l’autre côté de la frontière, malgré un accès restreint, la DDC a poursuivi son appui aux actions humanitaires dans l’Etat de Rakhine (Myanmar).