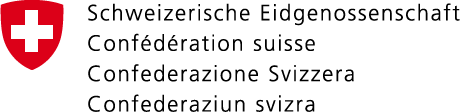Assurer l’accès aux ressources et aux services de base est essentiel pour les groupes de population défavorisés. En 2017, la coopération suisse au développement a accordé la priorité à des projets novateurs menés dans le secteur de la technologie et des finances ainsi qu’au travail réalisé dans le domaine de l’éducation.
Assurer l’accès de tous aux ressources et aux services de base
-

800 enfants déplacés et de la population hôte sont actuellement accueillis dans l’Espace amis des enfants de Rwangoma. Cette localité compte 886 ménages déplacés (env. 4'500 personnes) alors que la population habituelle avoisine les 3'400 ménages. © DDC
-

«Maman DIVAS», responsable de la Division des Affaires Sociales (DIVAS) du Secteur de Rwenzori. Elle gère les Centres de Rattrapage Scolaire (CRS), destinés aux enfants hors âge de scolarisation primaire n’ayant pas été scolarisés © DDC
-

Les formations offertes dans le cadre du programme Promost inclut différentes filières telles que la menuiserie. Un accent particulier est mis sur la formation pratique afin de fournir à ceux qui y participent des connaissances qui leur permettront d’être compétitifs sur le marché du travail. © DDC
-

Une sensibilisation particulière est faite autour des filières et métiers souvent considérés comme réservés aux hommes. © DDC
-

Le choix des filières de formation à offrir aux populations locales est fait sur base des besoins exprimés par les populations. Ainsi le programme Promost vise à ce que les étudiants issus de ces formations soient en mesure de s’intégrer dans le marché du travail. © DDC
-

De plus en plus de femmes s’intéressent aux métiers traditionnellement considérés comme exclusivement masculins. © DDC
Miser sur l’école et la formation pour sortir de la crise
Rwanda, Burundi et RDC: ces trois pays de la région des Grands Lacs à forte croissance démographique ont été, depuis les années 1990, le théâtre d’une succession de conflits, de violation des droits humains et de déplacements de population. Au Rwanda, pour sortir de la crise et répondre aux besoins d’une population jeune toujours plus nombreuse, le gouvernement a choisi de placer l’éducation au centre de ses priorités. La DDC appuie des projets dans ce secteur dans ces trois pays.
L’éducation, qui inclut l’éducation de base et la formation professionnelle, revêt une importance cruciale dans les contextes de conflits: elle offre aux enfants et aux jeunes une protection, des perspectives d’avenir et la possibilité de participer au développement économique, social et politique de leur pays. L’éducation est un droit humain fondamental et un important facteur de cohésion; elle joue un rôle clé dans la construction de la paix. S’alignant sur sa nouvelle stratégie éducation et l’agenda 2030 pour le développement durable, la DDC renforce son engagement dans les contextes fragiles non seulement en Afrique, mais aussi en Asie et Amérique latine.
Appui de la Suisse dans les provinces congolaises du Nord et Sud-Kivu
Dans l’est de la RDC, traversé par des conflits récurrents, les enfants et les jeunes sont exposés à de multiples formes de violences: abus, exploitation sexuelle, travail forcé, recrutement par des groupes armés. 7 millions d’enfants ne sont pas scolarisés en raison du conflit et du manque d’écoles en RDC. Les offres de formation sont limitées et la plupart des jeunes sans emploi. Au Nord-Kivu, la DDC finance un projet d’éducation de base et de protection des enfants affectés par les conflits. Au Sud-Kivu, elle appuie le développement d’une offre de formation professionnelle de qualité adaptée aux besoins socio-économiques locaux pour promouvoir l’emploi et les revenus.
Education de base et protection sont indissociables en situation de crises
«Maman Divas», gestionnaire scolaire dans le Nord-Kivu, est contente du projet financé par la DDC: «Les méthodes d’enseignement qui permettent aux enfants de rattraper les années scolaires perdues combinées avec un travail sur les traumatismes favorisent leur développement. Le taux de réussite scolaire a augmenté.» Entre 2016 et 2017, le projet a bénéficié à plus de 20’000 enfants: des formations psychosociales et en droits de l’enfant dispensés aux enseignants, les cas d’abus suivis par des psychologues et des juristes et des activités récréatives complétant le programme scolaire figurent parmi les mesures mises en place. L’insertion scolaire des enfants déplacés a favorisé la cohésion entre familles déplacées et d’accueil. Lors de crises, retourner à l’école signifie retrouver une certaine normalité, de l’espoir, des perspectives d’avenir ainsi qu’une protection physique et psychologique, des facteurs importants pour le bien-être des enfants et de leurs familles. L’école est le lieu où les enfants réapprennent à vivre ensemble: elle véhicule des messages de paix, de réconciliation et de prévention de la violence.
La formation professionnelle: un sésame pour l’emploi
Delphin a appris la broderie, Célestine la menuiserie. Ils ont bénéficié des formations de courte durée financées par la DDC. Ils occupent aujourd’hui un emploi dans une entreprise locale. Maçonnerie, soudure, mécanique moto, couture, maroquinerie ou coiffure figurent parmi les 19 filières de métiers identifiées comme prometteuses dans la ville de Bukavu. Grâce aux compétences professionnelles acquises, les chances de trouver un emploi mieux rémunéré augmentent considérablement, comme le souligne Delphin: «Avant la formation, je faisais des emplois occasionnels de couture et gagnait 1 à 2 USD par jour. Maintenant je suis engagé dans un atelier et je touche au minimum 60 USD par mois». Les bénéficiaires sont des jeunes non scolarisés ou très peu: orphelins, ex-combattants, filles mères, déplacés. Près de 600 jeunes ont été formés, la moitié sont des femmes. Célestine, mère célibataire se réjouit de voir qu’elle peut faire face aux frais scolaires de son fils et prendre sa vie en main.
Les technologies satellite au service des riziculteurs

203'000 riziculteurs indiens sont indemnisés grâce à des technologies qui «voient à travers les nuages». Ce résultat est le fait du projet RIICE, qui combine les objectifs d’amélioration de la sécurité alimentaire et d’inclusion financière de la DDC.
En Inde, 203'000 paysannes et paysans ont reçu pour la première fois en 2017 une indemnisation rapide pour des pertes de récoltes dues à la sécheresse. Plus d’un million d’autres devraient pouvoir bénéficier d’une couverture assurances-récolte similaire d’ici 2019.
Ces résultats encourageants sont le fait du projet RIICE (Remote sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging economies), qui combine les objectifs d’amélioration de la sécurité alimentaire et d’inclusion financière de la DDC.
En associant – grâce à un logiciel innovant développé par une entreprise suisse (sarmap SA) – l’analyse d’images satellitaires disponibles gratuitement (ESA) et la puissance de modélisation d’un software de l’IRRI (centre de recherche international public), RIICE produit des projections nationales fiables sur la production rizicole. Il promeut parallèlement l’utilisation de ces informations pour améliorer des programmes d’assurance agricole. Le réassureur SwissRe, un leader mondial du secteur, a testé positivement cette technologie et commence à l’intégrer dans des contrats d’assurance dont les clients sont des petits producteurs et productrices. De telles assurances offrant des compensations de l’ordre de 100 CHF suffisent souvent à éviter que ces paysannes et paysans ne retombent dans une situation de pauvreté en cas de pertes de récolte.
La DDC a joué un rôle clé dans la mise en œuvre du partenariat public-privé RIICE: elle a stimulé l’association des forces respectives des deux entités pour soutenir à la fois des dynamiques institutionnelles et des solutions technologiques accessibles ensuite durablement via le marché. Aujourd’hui, dans une région qui concentre 90% de la production mondiale de riz, Les Philippines ont intégré la technologie, alors que le Vietnam et le Cambodge sont en passe de le faire.
Améliorer la sécurité alimentaire grâce à la technologie satellitaire, RIICE (en)
L’État ne paie que si les personnes trouvent un emploi

Avec le soutien de la Suisse, la Colombie a été le premier pays en développement à lancer, en mars 2017, une obligation à impact social.
Une obligation à impact social est un contrat de prestations public-privé à finalité sociale. Des investisseurs privés préfinancent un projet et assument ainsi les risques associés. L’État ne rembourse les fonds que si des résultats mesurables sont enregistrés.
Un emploi durable pour les personnes pauvres
Les obligations à impact social ont pour objectif de faire accéder les populations pauvres au marché du travail. Un groupe de fondations financent les mesures appropriées. Le gouvernement colombien ne rembourse la totalité des fonds que si les personnes obtiennent réellement un emploi qu’elles occupent encore plusieurs mois après l’embauche et si elles sont enregistrées auprès des assurances sociales publiques. L’obligation à impact social est soutenue par la Banque interaméricaine de développement et le SECO.
Deux nouvelles obligations à impact social seront encore lancées ces prochains mois en Colombie. Il s’agit notamment de faire connaître cet instrument aux différents services gouvernementaux. La coopération avec les universités doit également être renforcée.
L’État définit les objectifs, le secteur privé se charge de la mise en œuvre
Les obligations à impact social ne sont pas une solution universelle. Leur mise en œuvre est complexe et elles doivent s'appuyer sur de solides bases de données. Les objectifs doivent être faciles à mesurer, tandis que les coûts et l’utilité doivent être soigneusement évalués. Les obligations à impact social encouragent ainsi une gestion novatrice et efficace des dépenses publiques. L’État détermine le but à atteindre. Les partenaires décident quant à eux de la manière d’atteindre ce but. La qualité et les résultats sont contrôlés par des organes indépendants.
Le SECO soutient les obligations à impact social en Colombie dans la perspective d’apporter un soutien aux populations les plus démunies. Il s’agit aussi de mettre en place de nouveaux mécanismes de financement permettant de mieux progresser dans la réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU.