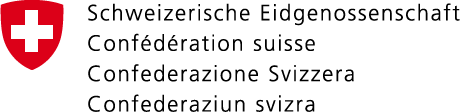Les mouvements migratoires sont multiples. Parmi les raisons qui poussent des millions de personnes à quitter leur pays, on peut citer le besoin de sécurité, les perspectives d’emploi et la quête d’un avenir meilleur. En 2017, la Suisse s'est mobilisée pour la sécurité et le statut juridique des migrants.
Migration

De Batticaloa à New York: allier solutions personnelles et solutions globales pour régulariser les migrations et assurer la sécurité des migrants
Dans l’Est du Sri Lanka, Sevanthy s’occupe de ses trois enfants tandis que son mari travaille au Qatar. L'argent que ce dernier envoie à la maison permet de scolariser les enfants et de couvrir les besoins élémentaires de la famille. Le dispositif financé par la DDC pour une migration sans risque de la main-d'œuvre (Safe Labour Migration Programme) a permis à Sevanthy de suivre un programme d'alphabétisation financière, grâce auquel elle sait maintenant gérer l’argent qu’elle reçoit chaque mois. Elle est maintenant capable de définir des priorités et d’établir un budget sans difficulté, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Lancée au Sri Lanka en 2013, cette initiative s’inscrit dans la stratégie générale de la DDC visant à assurer que le travail des migrants bénéficie au développement des pays et à leurs populations, de sorte que personne ne soit laissé de côté.
Sensibilisation et mise en place de conditions équitables
Pour de nombreux Sri Lankais, trouver un emploi à l’étranger, le plus souvent au Moyen-Orient, est le seul moyen de pourvoir aux besoins de la famille. Mais le fait de travailler dans un autre pays implique de nombreux défis, en particulier pour les travailleurs peu formés et les familles qu’ils laissent derrière eux. La DDC aide les personnes qui se sentent contraintes à émigrer à comprendre leurs droits et leurs obligations, et à évoluer dans des situations difficiles, que ce soit dans le cadre de leur travail à l’étranger ou lors de leur retour à la maison. Les familles reçoivent une aide sur place pour faire face à l'absence d’un père ou d’une mère ainsi que des conseils pour gérer l'argent qu’elles reçoivent de l’étranger. Les processus de recrutement sont quant à eux rendus plus transparents et conformes aux normes internationales.
Partir d’expériences personnelles pour trouver des solutions globales
Si les défis sont toujours bien présents, la DDC a aidé les gouvernements, le secteur privé, les employeurs et la société à réfléchir ensemble à la façon d’améliorer la situation des travailleurs migrants et de leurs familles. Son travail avec les personnes, les autorités locales et les gouvernements s’inscrit dans des processus régionaux au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Ces dialogues régionaux réunissent les gouvernements dans l’optique d'une migration économique profitable au développement durable.
Les expériences personnelles et les différents témoignages alimentent les efforts globaux déployés afin de mettre en place un cadre commun pour la gouvernance des flux migratoires: un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. La Suisse facilite le processus dans le cadre de son action visant à réduire les inégalités (objectif de développement durable 10 de l’Agenda 2030). Le travail réalisé en amont du pacte comprend un bilan de la situation, suivi de négociations.
Les négociations internationales menées à New York tiennent compte des réalités qui prévalent au Sri Lanka, dans le petit village de Batticaloa où vit Sevanthy, ce qui montre bien que le pacte mondial sur la migration est un instrument complet, construit à partir des expériences réalisées à tous les niveaux. Cette approche, qui intègre la voix de personnes ordinaires, aidera à faire du pacte un instrument pertinent et inclusif.
La migration du travail – Mise en place de conditions de travail décentes
La mobilité: un facteur de développement

Les populations de l’Afrique de l’Ouest sont historiquement parmi les plus mobiles du monde, mais l’essentiel de ces mouvements s’opère au sein même de la région. «La mobilité représente un facteur de développement traditionnel en Afrique de l’Ouest et la DDC oriente son action principalement sur cette migration circulaire, afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans la région», explique Chantal Nicod, cheffe de la Division Afrique de l’Ouest.
La coopération régionale transfrontalière au bénéfice des populations
Au travers de programmes développés à l’échelle régionale, la DDC contribue à promouvoir le dynamisme économique et la création d’opportunités en faveur de la mobilité et de l’intégration régionale. En s’engageant dans la coopération régionale transfrontalière, elle agit en faveur d’un meilleur accès des populations aux services de base et aux infrastructures. Donner des perspectives professionnelles aux jeunes dans une région où la démographie est très élevée, promouvoir le développement économique local, la citoyenneté, la tolérance et la paix permet d’apporter une réponse aux causes de la migration. Grâce au programme d’éducation des populations pastorales par exemple, près de 10’000 éleveurs nomades ont pu recevoir une éducation de base et près de 2000 une formation professionnelle. Plus d’un tiers de femmes en ont bénéficié. La DDC contribue aussi à sécuriser les passages des troupeaux afin de réduire les conflits entre les populations nomades et sédentaires dans les zones transfrontalières sensibles. Forte de son expérience du terrain, elle s’engage aux niveaux national, régional et global pour la recherche de solutions politiques aux questions migratoires en vue du développement durable. Elle soutient par exemple la politique migratoire nationale du Burkina Faso, du Nigeria et du Bénin, ainsi que de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Le Niger au cœur des enjeux migratoires
Au carrefour des routes migratoires entre l’Afrique subsaharienne et le Maghreb, le Niger est particulièrement confronté aux défis migratoires. Entre octobre 2016 et mai 2017, plus de 130’000 migrants ont transité par la région d’Agadez. Suite aux attaques répétées du groupe extrémiste Boko Haram, ce pays accueille aussi un grand nombre de personnes déplacées. La DDC appuie un projet de l’ONG italienne COOPI visant à fournir un soutien psychosocial et un environnement sécurisé aux victimes. Pour mieux comprendre les phénomènes et les enjeux de la migration pour le développement, la DDC a créé un groupe de dialogue qui rassemble les donateurs, des chercheurs, la société civile et le gouvernement nigérien. Elle soutient également la réalisation d’études d’un groupe de chercheurs nigériens de l’Université de Niamey portant sur diverses problématiques liées à la migration, comme le retour, la réinstallation et la circulation des migrants, les enjeux sécuritaires et l’intégration régionale, les migrations féminines ou encore le lien entre migration, pauvreté et changement climatique.
Le SECO ouvre de nouvelles perspectives
Le SECO ouvre de nouvelles perspectives économiques dans ses pays partenaires afin que les habitants ne soient pas contraints d’émigrer. À cette fin, il soutient des programmes qui encouragent la création d’entreprises et renforcent les compétences spécialisées des personnes à la recherche d’un emploi. Il permet en outre aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux capitaux sur le long terme et améliore l’environnement dans lequel elles évoluent. Il s’attaque ainsi aux causes structurelles de la migration.
Le «SECO Start-up Fund» a d’ores et déjà fait ses preuves: ce fond offre aux investisseurs dont le siège est en Suisse des prêts pouvant s’élever jusqu’à 500’000 CHF afin de soutenir des projets prometteurs menés par le secteur privé dans les pays en développement. Les prêts ne doivent pas dépasser 50% des frais investis et le remboursement est soumis à un délai de 5 ans. Depuis son lancement, en 1998, jusqu'à fin 2017, le «SECO Start-up Fund» a accordé environ 130 prêts dans 34 pays pour un montant total de plus de 36 millions CHF. On peut partir du principe que chaque franc prêté entraîne un investissement subséquent de 10 CHF.
Le SECO cherche par ailleurs à renforcer les compétences spécialisées des employés dans ses pays partenaires. En effet, les personnes bien formées s’intègrent mieux sur le marché du travail et font augmenter la compétitivité de leur entreprise. En Égypte, en Tunisie, au Maroc et en Jordanie, le SECO soutient ainsi le programme d’inclusion économique de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) depuis la fin de l’année 2017. Ce dernier aide le secteur privé à développer des programmes de formation sur mesure tenant compte des besoins des entreprises. Le programme cherche en particulier à intégrer les groupes de population les plus touchés par le chômage: notamment les jeunes adultes, les femmes et les personnes issues de régions défavorisées.