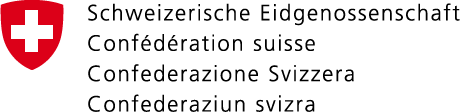Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur le Conseiller d’Etat,
Monsieur le Président,
Chers étudiants,
Mesdames, Messieurs,
Solférino. Pourquoi commémorer cette bataille qui a eu lieu il y a plus de 150 ans ? Pourquoi nous souvenir d’un combat qui a opposé l’empereur des français à l’empereur d’Autriche ? Cela semble bien loin, après tout…
Mais la bataille de Solférino n’est pas un événement singulier, perdu à l’aube de l’histoire de l’Europe moderne. Solférino est bien plus. C’est le symbole de la souffrance qu’inflige la guerre. Qu’infligent toutes les guerres.
Solférino est devenu synonyme de l’absurde violence de la guerre, lorsqu’elle devient machine à tuer et à broyer des êtres humains et leur dignité, Solférino c’est la bataille qui ne laisse que des cris, des larmes et des perdants.
En regardant le monde aujourd’hui on est obligé de constater, hélas !, que Solférino, n’est pas qu’une bataille du dix-neuvième siècle. Solférino, c’est aujourd’hui !
Aujourd’hui, en Syrie, le conflit se prolonge, s’embourbe, et empire. Ses victimes – blessés, tués, mutilés – se chiffrent en centaines de milliers. Selon l’ONU, la guerre civile aurait causé plus de 93'000 morts. Au moins 6'000 tués sont des enfants et une très grande partie des victimes sont des civils.
A cela s’ajoute des millions de personnes déplacées ou ayant besoin d’aide humanitaire. La guerre d’aujourd’hui n’épargne personne, militaires ou civils, femmes ou hommes, adultes ou enfants.
Solférino était une bataille entre armées régulières. Cela n’enlève rien à sa brutalité, mais cette violence est évidemment pire encore quand ses victimes sont des enfants ou leurs mères.
Car la guerre actuelle ne se cantonne plus à un espace délimité, où un général dispose ses armées en ordre de bataille. La guerre est devenue plus multiforme. Les combats se déroulent sur les places publiques, dans les rues, les marchés se transforment en champs de bataille, même les écoles, qui devraient être les sanctuaires de l’innocence et les fondements de l’avenir se retrouvent sur la ligne de front. Mêmes des hôpitaux sont devenus la cible de franc-tireurs.
Le danger est plus grand, bien plus grand qu’au temps de Solférino pour les enfants, les femmes et les civils. Aujourd’hui, la population civile est la principale victime des conflits armés et c’est bien le principal défi actuel du droit international humanitaire, cet instrument d’atténuation des souffrances que l’humanité a créé pour tenter de se racheter des horreurs de Solférino.
L’action humanitaire n’est donc, hélas, pas moins nécessaire qu’il y a 150 ans. Au contraire !
Face à l’étendue des tourments endurés par les victimes de la guerre, l’élan initié par Henry Dunant se poursuit, notamment à travers le travail du Mouvement international de la Croix-Rouge.
Voilà pourquoi en ce jour qui nous rappelle la bataille de Solférino et ses 40'000 victimes, la Suisse veut s’en souvenir pour agir.
Se souvenir, c’est rappeler que la bataille qui a découlé de Solférino, celle pour préserver la dignité humaine au milieu des décombres des conflits armés, est loin d’être gagnée.
Agir, c’est aller au secours des victimes des conflits d’aujourd’hui, leur prêter assistance, et chercher à faire mieux connaître, mieux comprendre et mieux respecter le droit international humanitaire.
Le Comité international de la Croix-Rouge, représenté ici par son président, fête cette année ses 150 ans. Il est une conséquence directe du traumatisme vécu par Dunant à Castiglione, traumatisme qu’il décrit dans son livre de 1862 « Un souvenir de Solférino ». A 150 ans, le CICR est pourtant plus jeune que jamais, il fait la preuve au quotidien de sa pertinence et de son utilité alors que le monde a profondément changé depuis 1859.
Chaque jour, le CICR nous rend témoins de sa détermination, de celle des hommes et des femmes qui y agissent, de son efficacité et de sa nécessité absolue dans une multitude de contextes difficiles aux quatre coins du globe.
Ses délégués prennent des risques pour porter assistance aux victimes de la guerre et perpétuent par là l’esprit et les valeurs nées à Genève : en 1859 lorsque les Genevois, émus par les témoignages épistolaires de Dunant, ont décidé d’envoyer une mission de secours à Castiglione, puis en 1863 lorsqu’on créa, ici, le Comité international de secours aux militaires blessés qui deviendra plus tard le Comité international de la Croix-Rouge.
Le CICR aujourd’hui, c’est le plus beau visage de l’humanité. Et l’humanité le sait : qui d’autre fut 3 fois prix Nobel de la Paix ?
La Suisse entretient une relation privilégiée avec le CICR, depuis sa création. Cette relation ne se base pas seulement sur un berceau commun, cette Genève devenue le cœur de la « Suisse internationale » et une place si utile pour préparer l’avenir du monde. Elle ne repose pas seulement sur des armoiries qui sont le complément l’une de l’autre. Cette coopération s’est surtout construite et elle perdure sur la base de valeurs communes. Les fondations les plus solides qui puissent être.
La Suisse et le CICR défendent les mêmes principes : nous visons à protéger les victimes des conflits armés, sans distinction aucune, et à tout mettre en œuvre pour que soit respecté le droit international humanitaire.
Ces thématiques clés offrent au CICR et à la Suisse un terrain où ils s’engagent ensemble dans le cadre des célébrations des anniversaires de 2013 et de 2014 – les 150 ans de la fondation du CICR cette année et les 150 ans de la première Convention de Genève l’an prochain.
Ce qui importe réellement, ce n’est pas l’âge de l’organisation, ce ne sont pas les anniversaires, ni les chiffres. Ce qui compte, c’est le travail qu’accomplit le CICR aujourd’hui et demain, ce sont les avancées dans la protection effective apportée aux victimes de la guerre, c’est le renforcement du respect du droit international humanitaire. La Suisse remercie le CICR de son engagement sans faille et elle aimerait, en ce jour symbolique, l’inviter à poursuivre son travail, absolument essentiel.
Mesdames et Messieurs,
La Suisse se sent chargée d’une responsabilité particulière. Parce que le CICR est basé ici, parce qu’elle porte dans sa politique extérieure et dans sa Constitution ces valeurs. On y stipule notamment la tâche de soulager les souffrances des populations dans le besoin. Le gouvernement suisse accorde dès lors une place importante à l’aide humanitaire dans sa stratégie de politique étrangère.
Et puis la Suisse se sent une responsabilité particulière en tant que dépositaire des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, documents clés du droit international humanitaire.
Dans un monde qui change vite, où les équilibres et les déséquilibres évoluent sans cesse, la Suisse veut mener une politique extérieure basée sur les principes de « neutralité, responsabilité et solidarité ».
C’est ce qui la conduit à œuvrer pour le respect, la promotion et le renforcement du droit international humanitaire.
C’est aussi ce qui a amené son Parlement à voter l’an dernier une augmentation substantielle des crédits de l’aide humanitaire et de la coopération internationale. Aujourd’hui 10e donateur mondial, la Suisse accordera dès 2015 une aide à hauteur de 0,5% de son revenu national brut, soit 1 franc par jour et par habitant.
La Suisse donne corps à son partenariat étroit avec le CICR en l’appuyant tout particulièrement dans la répartition de ses soutiens financiers. Au cours des deux dernières décennies, le CICR a bénéficié d’un tiers du budget de l’Aide humanitaire suisse, ce qui fait de la Confédération le deuxième contributeur du CICR.
La Suisse contribue ainsi à la mise en œuvre des nombreuses activités du CICR:
- protection des civils dans les conflits armés,
- assistance aux victimes,
- dialogue avec les forces armées et les groupes armés non étatiques,
- et renforcement du droit international humanitaire,
pour ne citer que les plus importantes.
Mesdames, Messieurs,
Les Etats ont une responsabilité humanitaire. Une responsabilité face à notre humanité partagée qui n’est jamais autant mise à mal que dans des situations de conflit.
La Suisse est convaincue que l’aide humanitaire doit atteindre toutes les victimes des guerres, sans égard à leur lieu de naissance, à leur appartenance ethnique ou à leur statut social. L’aide humanitaire doit être fournie en toute indépendance, c'est-à-dire sans considération politique.
La Suisse agit dans quatre domaines humanitaires stratégiques, aussi bien de manière bilatérale - avec l’État concerné - que multilatérale, en coordination avec de nombreux acteurs.
Le premier moment est celui de la prévention. Nous cherchons à empêcher les crises humanitaires avant qu’elles n’éclatent et, lorsque ce n’est pas possible, à atténuer au maximum leurs conséquences. Pour ce faire, nous avons identifié des tâches concrètes, en particulier le soutien à des mécanismes locaux de prévention dans les zones à risques, la mise en place de systèmes d’alerte, l’observation des zones à risques, le renforcement des capacités civiles de gestion autonome des risques, la recherche systématique de solutions pacifiques aux conflits et le renforcement de la coordination internationale des efforts d’assistance. C’est le cas en Arménie, par exemple, où nous participons au renforcement des systèmes de sauvetage décentralisés.
Le deuxième moment clé de notre action humanitaire, c’est l’aide d’urgence. C’est l’image qu’on se fait couramment de l’aide humanitaire ; ces grands camions qui transportent des vivres, ces tentes où du personnel soignant vient en aide aux victimes, ou encore ces vastes camps où des milliers de réfugiés viennent s’établir dans l’espoir de retrouver un semblant de l’humanité qui leur a été volée.
Concrètement, l’aide d’urgence signifie une intervention rapide et ciblée pour répondre aux besoins fondamentaux des victimes de conflits. La Suisse a été active sur la plupart des théâtres de conflits ou de catastrophes naturelles, comme en Somalie, à Haïti ou au Pakistan.
Le troisième moment est celui de la reconstruction. Une crise humanitaire marque à vie, elle brise les rêves et ternit les opportunités, elle sépare des familles, elle démolit les infrastructures, détruit l’environnement et bouleverse les institutions. Les survivants ont la lourde tâche de recommencer une vie avec le peu qu’il reste. Pour la Suisse, l’effort humanitaire doit donc se poursuivre bien au-delà du conflit et alors même que les caméras se sont déjà tournées ailleurs. Au Pakistan, l’aide humanitaire de la Confédération s’est concentrée sur la reconstruction des centres de soins jusqu’à deux ans après le tremblement de terre qui a meurtri le pays en 2005.
Enfin, la Suisse s’engage à attirer l’attention de la communauté internationale sur des conflits oubliés. Certaines crises attirent d’avantage d’attention que d’autres. Il est primordial de ne pas s’adonner à un exercice arbitraire de classification de la souffrance. La Suisse œuvre en faveur des ces victimes « oubliées », loin de nos yeux et de nos écrans, comme en République Démocratique du Congo ou en République Centre-Africaine.
Se souvenir de Solférino pour agir, c’est donc prévenir, aider, reconstruire, plaider.
Mesdames et Messieurs,
Les Solférino d’aujourd’hui ne sont plus ceux du XIXe siècle ni ceux du XXe et ceux de demain seront différents encore. Nous vivons dans un monde qui change vite. Les technologies et les sciences font des progrès formidables ; des progrès qui ont toutefois aussi leurs mauvais côtés.
Les conflits changent aussi de nature, nos mécanismes d’action humanitaire arrivent parfois à leurs limites. Il nous faut donc innover : construire un système adapté aux réalités du monde d’aujourd’hui.
Je me réjouis donc de la discussion de ce jour sur les défis de l’action humanitaire. Je suis particulièrement heureux qu’elle ait lieu devant, et avec, un public jeune. Car le monde de demain, chères étudiantes et chers étudiants, c’est le vôtre. Et sa qualité dépendra en partie des réponses qui seront apportées dans ce processus de modernisation de l’action humanitaire.
J’aimerais lancer les réflexions en évoquant deux défis centraux pour l’action humanitaire.
1. Le premier concerne la sécurité des humanitaires dans les conflits armés. Depuis environ dix ans, nous constatons une multiplication des attaques en tous genres contre les acteurs humanitaires. Le CICR a encore été attaqué dernièrement en Afghanistan et ailleurs. Ces attaques empêchent un accès correct aux victimes et rendent le travail dans certains contextes extrêmement difficile et limité. Le cas syrien est évidemment tristement typique de cette tendance. C’est la raison pour laquelle la Suisse a invité le gouvernement syrien à autoriser des opérations humanitaires transfrontières coordonnées par les Nations Unies et le CICR, en accord avec les pays voisins.
Les causes de cette nette détérioration du contexte sécuritaire sont multiples. Il y a l’évolution de la nature même des conflits - avec la multiplication des parties aux conflits et la complexité des champs de batailles. Il y a également, depuis la fin de la guerre froide, la présence d’un nombre croissant d’acteurs humanitaires dans des contextes sensibles et à proximité des zones de combat. Or ces contextes souvent complexe favorisent des attaques contre les humanitaires pour des motifs politiques ou économiques.
Et puis certains Etats mêlent opérations militaires et aide humanitaire. Ceci mine la crédibilité de missions qui doivent impérativement rester indépendantes pour être acceptées. La neutralité est ici essentielle, agir autrement c’est faire courir des risques de sécurité importants aux humanitaires.
Il devient donc de plus en plus difficile de maintenir une action sécurisée basée sur les principes humanitaires. Et si le droit international humanitaire offre une protection juridique (certaines attaques pouvant même parfois être qualifiées de crimes de guerre), l’impunité régnante dans la plupart de ces contextes rend souvent cette protection peu efficace.
Il est urgent de réfléchir à des solutions concrètes pour remédier à ce problème. Il en va de la sécurité du personnel humanitaire et par là de l’avenir-même de l’action humanitaire.
La Suisse a décidé d’agir sur un plan politique, légal et opérationnel pour accroitre la sécurité du personnel humanitaire. Nous sommes en train de développer une stratégie pour la protection des civils dans les conflits armés. Nous œuvrons pour sensibiliser le public à la question de la sécurité des acteurs humanitaires. Nous élaborons en outre deux manuels destinés à fournir des informations et des conseils pratiques concernant l’accès humanitaire et la sécurité du personnel sur le terrain.
2. Le deuxième défi dont j’aimerais parler a trait au respect du droit international humanitaire. Une question d’une importance fondamentale car il en va à la fois de la protection des victimes des conflits et de la crédibilité du droit international humanitaire.
Le droit international humanitaire offre, dans l’ensemble, un cadre juridique approprié pour régir le comportement des parties à un conflit armé, malgré un contexte qui a évolué. Mais le respect de ces normes de droit lors de conflits est trop souvent insuffisant.
En juillet 2012, la Suisse et le CICR ont organisé une première réunion pour renforcer le dialogue entre Etats sur ces questions. C’est que les mécanismes prévus pour assurer le respect du droit international humanitaire, établis par les Conventions de Genève, se sont jusqu’ici révélés inadéquats.
Les Etats sont arrivés à la conclusion qu’une des raisons du non-fonctionnement de ces mécanismes est l’absence de structure institutionnelle. Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels sont les seuls traités internationaux relatifs à la protection des personnes qui ne donnent pas la possibilité aux Etats de se rencontrer sur une base régulière.
La semaine passée, la Suisse et le CICR ont donc organisé une deuxième rencontre, ici même à Genève.
Les Etats y ont pris conscience que le moment était venu de trouver des moyens spécifiques pour assurer le respect du droit international humanitaire. Ils veulent se donner ces moyens par un dialogue accru et c’est réjouissant. La Suisse et le CICR vont maintenant élaborer des options concrètes qui seront discutées avec les Etats durant l'année à venir.
Mesdames, Messieurs,
Ces deux défis – la sécurité des travailleurs humanitaires et le respect du droit international humanitaire – illustrent la complexité de la tâche qui est devant nous. Pourtant, il n’y a pas de quoi baisser les bras, pas plus que Dunant ne l’a fait. Solférino n’est pas seulement le symbole de l’inhumanité de la guerre, c’est aussi le symbole de l’action. L’action d’un homme qui a regardé dans les yeux des soldats blessés et qui s’est révolté.
L’action d’un homme qui s’est engagé bénévolement dans une infirmerie au lendemain de la bataille. L’action d’un homme qui a voulu agir pour soulager les souffrances et lutter contre les pires excès de la guerre. L’action d’un homme qui a soulevé des montagnes et a amélioré le sort de l’humanité.
Ce jour est important car, devant l’ampleur de cette tâche, nous aussi, devons nous souvenir de Solférino, et agir !
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente conférence.